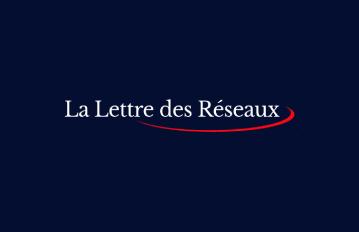CJUE, 7 juillet 2016, aff. C-70/15
L’interprétation des textes par la CJUE vise l’équilibre entre les différents principes fondamentaux de l’Union – libre circulation des décisions, droits de la défense, sécurité juridique…
Ce qu’il faut retenir : L’interprétation des textes par la CJUE vise l’équilibre entre les différents principes fondamentaux de l’Union – libre circulation des décisions, droits de la défense, sécurité juridique. La notion de « recours » telle que visée par l’article 34(2) du règlement Bruxelles I (désormais article 45(1) de Bruxelles I bis) doit s’interpréter comme incluant la demande de relevé de la forclusion, cela, dans l’objectif d’assurer un équilibre entre libre circulation des décisions de justice et respect des droits de la défense.
Pour approfondir : Le règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, (ou Règlement Bruxelles I), qui régit la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dans l’Union Européenne, vise la libre circulation des décisions judiciaires dans ces matières, et leur exécution rapide (considérant 6 du préambule, Bruxelles I). Ce principe toutefois, s’il part du constant que « certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur » (considérant 2, Bruxelles I), est parfois sujet à difficultés. La Cour de Justice, dans un arrêt du 7 juillet 2016, vient de nouveau préciser les conditions d’applicabilité de ce principe de reconnaissance mutuelle des décisions. L’article 34 du règlement prévoit quatre raisons pour lesquelles une décision n’a pas à être reconnue à l’échelle européenne :
- cette reconnaissance est « manifestement contraire à l’ordre public » de l’Etat membre dont la reconnaissance est requise ;
- « l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire » ;
- caractère inconciliable de la décision avec une décision antérieure rendue dans l’Etat membre requis, entre les mêmes parties ;
- caractère inconciliable de la décision avec une décision antérieure rendue dans un autre Etat (membre ou tiers).
En l’espèce, c’est la deuxième condition qui a ici intéressé la Cour et, à travers cette condition, la nécessité pour les juridictions, de parvenir à un « juste équilibre entre la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union, qui justifie que les décisions rendues dans un Etat membre soient reconnues et déclarées exécutoires de plein droit dans un autre Etat membre, et le respect des droits de la défense, qui impose que le défendeur puisse, le cas échéant, former un recours contre la décision » (§36). Si le « bon fonctionnement du marché intérieur » justifie la libre circulation des décisions, les droits de la défense doivent être respectés. En l’espèce, un résident français a obtenu du Tribunal de grande instance de Paris la condamnation d’un résident polonais. Toutefois, l’acte introductif d’instance n’a été ni signifié ni notifié à ce dernier, qui n’a eu vent de la décision que 15 mois plus tard, la signification n’intervenant que bien après. N’introduisant pas de demande de relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai, une décision déclare le jugement exécutoire en Pologne. Cependant, suite au recours du défendeur contre cette décision, la Cour d’appel polonaise réforme la décision, aux motifs que la demande de relevé de forclusion ne peut s’entendre comme un « recours » au sens de l’article 34(2) de Bruxelles I. C’est précisément la définition de la notion de « recours » qui fait l’objet d’une première question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne. La seconde question, sur le fondement du règlement n°1397/2007 pose le problème de l’applicabilité des dispositions nationales concernant la possibilité d’être relevé de la forclusion. La notion de « recours », est une notion autonome, qui ne dépend donc pas des définitions particulières pouvant exister dans les droits nationaux. C’est au regard des objectifs de confiance réciproque, de libre circulation des décisions, qu’elle doit s’interpréter, en équilibre avec les droits protégés par l’Union (§§ 32-34). Or, les droits de la défense sont respectés dès lors que l’intéressé « n’a pas eu connaissance de l’acte concerné en temps utile pour exercer un recours » (§44). Dans le cas contraire, si donc, ce dernier était en mesure de faire valoir son droit mais ne l’a pas fait, la Cour de justice souligne que « la reconnaissance d’un jugement prononcé par défaut à son encontre ne saurait être refusée sur le fondement de l’article 34, point 2 du règlement Bruxelles I » (§ 46). Puisque cette solution peut permettre l’équilibre entre la reconnaissance mutuelle des décisions et le respect des droits de la défense, la notion de « recours » dans l’article 34(2) « doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut également la demande tendant au relevé de la forclusion, lorsque le délai pour introduire un recours ordinaire a expiré » (§ 49). Réponse à la première question préjudicielle est rendue.
Il faut noter à ce stade que cette interprétation par la CJUE de la notion de « recours », dans ce contexte, est toujours à prendre en compte par les juges. En effet, le règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, réformant Bruxelles I et s’appliquant depuis le 10 janvier 2015, prévoit toujours la non-reconnaissance des décisions dans le cas prévu par l’article 34(2) susvisé, dans son article 45(1). Pour répondre à la seconde question, la Cour se fonde sur les caractéristiques inhérentes au Règlement : par nature, « il produit des effets immédiats et est apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l’obligation de protéger » (§51) (CJUE, 14 juill. 2011, C-04/10 et C-27/10 ; CJUE, 10 déc. 2013, C-394/12). Une nouvelle fois, l’interprétation que la Cour fait de l’article 19(4) du règlement n°1393/2007 objet de la demande d’interprétation, se fonde sur la nécessité de respecter les principes généraux du droit de l’Union – en l’espèce, sur la sécurité juridique. En l’espèce, l’article du règlement en question prévoit la possibilité de faire une demande de forclusion dans un « délai raisonnable », à deux conditions : (1) le défendeur n’a pas eu connaissance de l’acte pour se défendre, et (2) les moyens du défendeur ne sont pas dénués de fondement. Chaque Etat membre pouvait ensuite prévoir, dans une communication, un délai différent pour introduire cette demande ; la France prévoit un délai d’un an, délai qui, donc, est dépassé en l’espèce. Puisque le délai est dépassé, il serait contraire à la sécurité juridique d’appliquer, alternativement au règlement, les dispositions du droit national (§ 57). La Cour tranche ainsi : l’article 19(4) « exclut l’application des dispositions du droit national relatives au régime des demandes tendant au relevé de la forclusion, dès lors que le délai de recevabilité pour l’introduction de telles demandes, tel que spécifié dans la communication d’un Etat membre à laquelle se réfère ladite disposition, a expiré ». C’est bien l’équilibre entre les différents principes fondamentaux de l’Union – libre circulation des décisions, droits de la défense, sécurité juridique – qui est recherché dans l’interprétation des textes faite par la CJUE.
A rapprocher : Sur la nécessité de respecter les droits de la défense dans l’application de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice, voir CEDH, Krombach c. France, 13 février 2001, n° 29731/96


 3187 vues
3187 vues